|
|

|
Bibliographie 2ème année - Sciences sociales
Bonjour,
Pour
préparer au mieux votre rentrée, voici quelques conseils de lecture en lien
avec les thèmes qui seront abordés en khâgne. Il est évidemment vivement
conseillé d’en faire des fiches de lecture. Comme il s’agit de la partie la
plus fastidieuse, essayez de mutualiser vos efforts !
- Sur les thématiques de
socialisation et de culture, quelques ouvrages utiles :
M.
FERRAND, Féminin/masculin, Repères la découverte, 2004.
D.
PASQUIER, Cultures lycéennes, Ed. Autrement, 2005
B.
LAHIRE, La Culture des individus, Ed. La Découverte, 2006
- En économie, vous pouvez
lire ces ouvrages généraux de mise en perspective :
D.
COHEN, Trois leçons sur la société postindustrielle, 2006.
D.
PILHON, Le nouveau capitalisme, La découverte, 2009.
- Sur le thème du chômage :
CAHUC
et ZYLBERBERG, Le chômage, fatalité ou nécessité ?, Champs
Flammarion, 2009.
- A.ORLEAN, De l’euphorie à la panique, penser la crise
financière, Ed. de la rue d’Ulm, 2009 : un ouvrage que je vous
conseille si le sujet vous intéresse. Il est à la fois clair, précis et
synthétique.
- « La comptabilité nationale pour comprendre les
désordres internationaux » : intervention d’Agnès BENASSY-QUERE lors
d’un colloque à destination de
lycéens. http://www.kezeco.fr/Agnes-BENASSY-QUERE.
Un exposé limpide d’une spécialiste des politiques économiques sur un thème a
priori difficile (vidéo)
Ces
vacances peuvent être aussi pour vous l’occasion de « naviguer » sur
des sites qui proposent des ressources intéressantes. La liste n’est évidemment
pas exhaustive, et n’inclut pas les sites les plus connus, comme celui de
l’INSEE, incontournable :
- Le site de la Vie des
idées, et en particulier les articles suivants :
-
L’interview de Camille Landais sur le thème des
hauts revenus (titre le l’article « Des riches de plus en plus
riches ») : http://www.laviedesidees.fr/Des-riches-de-plus-en-plus-riches.html?decoupe_recherche=camille%20landais
-
une mise en pespective intéressante de Louis
Chauvel sur le thème des retraites (vidéo) : http://www.laviedesidees.fr/L-age-d-or-des-jeunes-retraites.html?decoupe_recherche=louis%20chauvel%2A
-
Un entretien avec André Orléan sur la crise
économique et financière : http://www.laviedesidees.fr/Quelle-regulation-pour-sortir-de.html
(intéressant par rapport au thème du programme « rationalité et
croyances »)
-
« La mixité sociale à l’école : une
affaire de famille ? » (compte-rendu par Elise Tenret d’un numéro
récent d’ARSS) : http://www.laviedesidees.fr/La-mixite-sociale-a-l-ecole-une.html?decoupe_recherche=mixit%C3%A9%20sociale
- Les sites de l’OFCE et
du CEPII offrent également des ressources intéressantes en matière de
politiques économiques, mais sans doute trop pointues par rapport à vos
connaissances actuelles. J’ai toutefois sélectionné une Lettre de l’OFCE
que vous pouvez d’ors et déjà lire : « Les inégalités en
héritage », no. 284, mars 2007 : http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/lettres/284.pdf,
qui peut utilement compléter votre cours sur les inégalités
- Le site de l’ENS-LSH
propose quant à elle des dossiers, fiches de lecture et compte-rendus
intéressants : http://ses.ens-lsh.fr/
- Moins académique,
mais stimulant, le blog des éconoclastes peut vous donner des envies
de lecture en économie (le site propose de nombreux compte-rendus de
lecture)
http://econoclaste.org.free.fr/
Enfin,
sachez que votre première série de colles portera sur vos deux derniers
chapitres d’hypokhâgne, c’est-à-dire sur la monnaie et sur la stratification
sociale.
Je
vous souhaite de très bonnes vacances,
Marie
Parenteau-Denoël
|

|
L’écart entre les positions
masculine et féminine s’est fortement réduit. Le quotidien des femmes de ce
début de siècle n’a que peu de rapports avec celui de leur mère et encore
moins de leur grand-mère. Elles ont acquis la capacité de décider de leur vie,
individuellement et socialement. Des bastions masculins sont tombés, d’autres
sont fortement menacés.
Mais le maintien têtu de
certaines discriminations sexuées, la reconstitution de nouvelles formes
d’inégalités là où on ne les attendait pas montrent que si la domination
masculine semble s’être atténuée, elle n’a pas disparu. Qu’il s’agisse des
salaires ou des responsabilités professionnelles, des mandats électifs ou des
charges parentales, de la visibilité dans la création ou de la liberté
sexuelle, le masculin l’emporte encore sur le féminin. L’objectif de cet
ouvrage est moins d’insister sur le maintien de ces inégalités que de
comprendre comment elles se déplacent, se reconstituent, mais aussi
s’atténuent. Et d’essayer de saisir la nature des forces qui œuvrent pour
leur extinction comme de celles qui y font résistance.
M.Ferrand, Feminin/Masculin, Ed. La Découverte, coll. Repères
n°389, mai 2004, 9.50€
Michèle
Ferrand est sociologue au
laboratoire Cultures et sociétés urbaines du CNRS et associée à l’unité
Démographie, genre et sociétés de l’INED. Elle est spécialiste des inégalités
entre les sexes, dans la famille, au travail et à l’école.
Introduction
- I / Travail professionnel, travail domestique - Travail et activité : une histoire des mots - 1.
Le travail productif : la part des femmes - L’accès des femmes au monde
du travail - Le maintien des inégalités ; ségrégation et qualifications -
Chômage et temps partiel - 2. Le travail domestique : la part des hommes -
L’invisibilité du travail domestique - Une participation masculine légèrement
en hausse ? - Un partage différentiel selon le type de tâche et le milieu
social - Négociations et travail domestique - II / Pères et mères - Un
nouveau régime démographique de la famille - 1. Décider de devenir parents
- Contrôle des naissances au masculin et pression nataliste - La décision
procréative aux mains des femmes - Le temps des femmes et l’emploi des hommes
- 2. La charge des enfants - La parentalité après la séparation -
Familles recomposées : une place différente pour les hommes et pour les
femmes - 3. Le registre du symbolique - La parentalité au masculin et
au féminin - Nouveaux modes de procréation : l’éclatement des notions de
maternité et de paternité - III / La socialisation selon le sexe - 1.
Famille et groupe de pairs - Des parents pleins de « bonne volonté
égalitaire » - Des pairs encore plus normatifs que les parents - 2.
L’école - Le temps de la différence - Le temps de la mixité - La
meilleure réussite des filles : une victoire à la Pyrrhus ? - IV / La
place des femmes dans l’espace public - 1. Stratification et mobilité
: où sont les femmes ? - La stratification sociale : comment classer les
femmes - La mobilité sociale : une notion au masculin - 2. Création et
sociabilité - La visibilité sociale du masculin et du féminin - La
sociabilité au masculin et au féminin - 3. La parité en politique -
L’exclusion des femmes - La parité en question : les réformes de 1999 - 4.
Le dernier bastion : le pouvoir économique et institutionnel - V / Amour,
sexualité et domination masculine - Les difficultés d’appréhender la
sexualité dans les sciences sociales - 1. Vers plus d’égalité : la fin de
la double morale - Le rapprochement du comportement des hommes et des
femmes - Le maintien de certaines différences - 2. Les transformations de
la sexualité conjugale - Les formes nouvelles de la conjugalité - Le
primat du désir masculin - La sexualité entre partenaires de même sexe - 3.
Viols et violences sexuelles - Conclusion - Bibliographie - L’émancipation
des femmes : repères chronologiques.
« [...]
Ce petit ouvrage, avec l'abondante bibliographie et les repères
chronologiques qui le prolongent, apporte une pierre intéressante et
documentée à l'analyse du genre. »
ANALYSES BIBLIOGRAPHIQUES
« Petit par la taille, Féminin, Masculin est en effet un très bon
ouvrage d'initiation aux rapports sociaux de sexe; à faire découvrir à toutes
les "mamans" et tous les "papas" en leur disant, au
besoin, que ce livre est un peu comme ceux d'Anna Gavalda (en moins drôle
mais plus fort): il leur parle d'eux.
GENÈSES
|
|
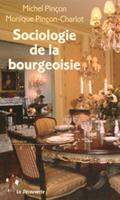
|
Ce livre lève un coin du voile qui recouvre les
mystères de la bourgeoisie et montre ce qui constitue en classe sociale ce
groupe apparemment composite. La richesse de la bourgeoisie est multiforme,
alliage d’argent – de beaucoup d’argent – de culture, de relations sociales
et de prestige.
Comment les bourgeois vivent-ils ? Comment sont-ils
organisés ? La bourgeoisie est-elle menacée de disparition ? Dans quelles
conditions ses positions dominantes se reproduisent-elles d’une génération à
l’autre ? Quel est le rôle des lignées dans la transmission de ces positions
? La bourgeoisie est-elle la dernière classe sociale ? C’est notamment à ces
questions sur cet univers méconnu et qui préférerait le rester que répond ce
livre rigoureux et accessible.
Pinçon et Pinçon-Charlot, Sociologie de la bourgeoisie, Ed. La
Découverte, coll. Repères n°294, 2007, 9.50€
|
|

|
La croissance économique, celle du PIB, est
aujourd’hui le principal critère de performance des nations, mais c’est aussi
un critère de plus en plus contesté. Dans ce livre, les auteurs dressent un
bilan de cette contestation, et surtout ils présentent de nouveaux
indicateurs synthétiques, fondés sur des visions alternatives de ce qui fait
« la richesse des nations ». Ces indicateurs s’intéressent selon les cas au «
développement humain », à la « santé sociale » ou au « bien-être économique »
d’une collectivité, mais aussi au développement durable. Ils permettent de
compléter les indicateurs économiques en tenant compte de richesses oubliées
comme celles que produisent le travail bénévole ou le travail domestique, de
richesses environnementales sacrifiées, ou encore de critères de cohésion
sociale et de pauvreté. Ils pourraient servir de guides à d’autres politiques
économiques et sociales. Ce livre a été écrit pour être très largement
accessible à des non-spécialistes, tout en fournissant aux lecteurs des
encadrés méthodologiques essentiels.
J. Gadrey et F.Jany-Catrice, Les nouveaux indicateurs de richesse,
Ed. La Découverte, coll. Repères n°404, 2007, 9.50€
|
|
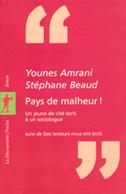
|
« Cher monsieur, je me permets de vous écrire pour vous
remercier. J’ai terminé votre enquête 80 % au bac. C’est un livre qui m’a à
la fois ému (j’ai souvent eu les larmes aux yeux) et mis en colère (contre
moi-même). C’est incroyable à quel point les vies que vous avez décrites
ressemblent à la mienne… » C’est ainsi que débute la correspondance
électronique entre le sociologue Stéphane Beaud, auteur de 80 % au bac et
après ?, et Younes Amrani, l’un des lecteurs de son livre, un jeune homme de
28 ans, qui travaille comme emploi-jeune à la bibliothèque municipale d’une
ville de la banlieue lyonnaise. Cette correspondance, qui va durer plus d’une
année, constitue un document exceptionnel sur les espoirs et les souffrances
intimes des jeunes d’origine maghrébine. Les confidences de Younes en disent
long sur le sentiment de non-reconnaissance et parfois d’abandon moral dont
il souffre au quotidien. À travers ce dialogue amical surgissent peu à peu
les différents aspects de l’histoire personnelle et familiale de Younes et
les contradictions sociales qui le traversent. Ce témoignage peut ainsi aider
à combattre la vision stéréotypée et réductrice du « jeune de banlieue ». Il
fait émerger, à travers la figure de son principal protagoniste, des traits
essentiels de la personnalité sociale de nombreux jeunes de cité : un esprit
de révolte, l’envie de comprendre le monde social, le goût pour la politique,
le sens de l’analyse.
Y. Amrani et S. Beaud, Pays de malheur, Ed. La Découverte, coll.
Poche/Essais n°211, 2005, 9 €
|
|
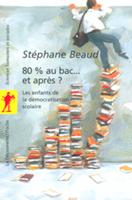
|
« 80 % d’une génération au
bac » : ce mot d’ordre, lancé en 1985 comme objectif de
l’enseignement secondaire français, fait l’objet d’un consensus politique,
satisfaisant le progressisme de la gauche enseignante et le pragmatisme des
gouvernements qui ont vu là un moyen de juguler le chômage de masse des
jeunes. Ce slogan a nourri les espoirs d’une possible promotion sociale pour
les enfants de familles populaires, en particulier immigrées, dans un
contexte d’insécurité économique et sociale croissante. Dans ce livre nourri
d’une enquête de dix années, Stéphane Beaud raconte, à travers les portraits
de jeunes d’un quartier HLM à forte composante immigrée, les illusions et les
désillusions de ces « enfants de la démocratisation
scolaire », engagés dans la voie incertaine des études longues. Il
montre comment ils ont dû déchanter alors qu’ils se voyaient peu à peu
relégués dans les filières dévalorisées du lycée et du premier cycle
universitaire. L’auteur met ainsi en lumière l’ambivalence de la politique
volontariste de démocratisation scolaire : d’un côté, une élévation
globale du niveau de formation et une forme de promotion sociale pour
certains et, de l’autre, un coût moral et psychologique important, voire
dramatique, pour ceux qui se retrouvent fragilisés par leur échec
universitaire et confrontés au déclassement social.
S.Beaud, 80% au bac… et après ?, Ed. La Découverte, coll.
Poche/Sciences humaines et sociales n°155, 2003, 11.50 €
|
|
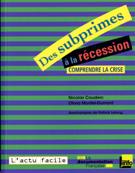
|
Voici un ouvrage simple et clair sur la crise
mondiale actuelle. Structurées chronologiquement, se déroulent les
différentes étapes, de la crise avec ses répercussions concrètes sur les
ménages et les entreprises, les interventions des banques centrales et des
gouvernements. Des repères pratiques : " Saviez-vous que ? ", des
encadrés et quelques schémas viennent compléter les analyses. Le lecteur
trouvera également des réponses aux questions concernant la suite de la crise
et les réformes à mettre en œuvre pour éviter qu'un tel scénario ne se
reproduise.
N. Couderc
et O.Montel-Dumont, Des subprimes à la récession : comprendre la
crise, Ed. La Documentation française, coll. L’actu facile, 2009, 10 €
|
|

|
Le problème de la
ségrégation urbaine en France ne se limite pas à quelques centaines de
quartiers dévastés par l’échec et la pauvreté. Ceux-ci ne sont que la
conséquence la plus visible de tensions séparatistes qui traversent toute la
société, à commencer par ses élites. À ce jeu, ce ne sont pas seulement des
ouvriers qui fuient des chômeurs immigrés, mais aussi les salariés les plus
aisés qui fuient les classes moyennes supérieures, les classes moyennes
supérieures qui évitent les professions intermédiaires, les professions
intermédiaires qui refusent de se mélanger avec les employés, etc. Le
phénomène est d’autant plus préoccupant qu’en enfermant le présent, les fractures
territoriales verrouillent aussi l’avenir des individus et les assignent à
des destins sociaux écrits d’avance. Tel est l’enseignement de cette enquête
au cœur du « ghetto français », qui révèle une société marquée par
la défiance et la recherche de l’entre-soi, et découvre en chacun de nous un
complice plus ou moins actif de la ségrégation urbaine.
E. Maurin, Le
ghetto français, Ed. Seuil/La République des Idées, 2004, 10.50 €
|
|
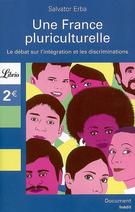
|
«Première, deuxième, troisième génération:
nous sommes tous des enfants d'immigrés!» Au lendemain du premier tour des
élections présidentielles de mai 2002, ce slogan fleurissait un peu partout
dans les rues, dans les écoles, dans les médias. Depuis, le climat social
français ne s'est pas apaisé, le paroxysme ayant été atteint lors des émeutes
de novembre 2005. Le fameux «modèle français d'intégration» est-il en échec?
Faut-il dès lors changer de modèle en important la discrimination positive
mise en œuvre dans certaines sociétés pluriethniques? C'est à ces questions
que cet ouvrage inédit s'efforce de répondre, en s'appuyant sur des archives
journalistiques, des rapports officiels et des témoignages de première main,
pour apporter un éclairage nouveau sur les origines pluriculturelles de la
France.
S. Erba, Une
France pluriculturelle, Librio, 2007, 2 €
|
|

|
Le marché est plus que jamais une
réalité incontournable, qui pèse sur notre organisation sociale et sur notre
vie quotidienne. Est-ce à dire que le marché, à lui seul, fournit les clés de
l’avenir ? Pour répondre à cette question qui, le plus souvent, suscite des
réactions aussi partielles que partiales, Roger Guesnerie tient la gageure de
dresser un panorama objectif et éclairant des économies de marché. Son regard
se porte sur leur construction au fil de l’histoire, sur les débats intellectuels
et les polémiques politiques que leur fonctionnement a suscités. Il examine
ensuite quelques-uns des défis auxquels les économies de marché sont
confrontées au XXIe siècle.
R.
Guesnerie, L’économie de marché, Ed. Le Pommier, 2006, 7 €
|
|
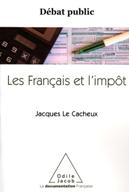
|
" Impôts, cotisations sociales, prélèvements
obligatoires : de quoi parle-t-on ? " " Les déficits publics
d'aujourd'hui sont-ils les impôts de demain ? " " Pourquoi certains
produits d'épargne bénéficient-ils d'un traitement fiscal favorable ?"
" Faut-il imposer les revenus à la source ? " " Les
réductions/exonérations de cotisations sociales créent-elles de l'emploi
?" " Pourquoi distingue-t-on cotisations patronales et salariales ?
" Cet ouvrage offre des éléments de réponse aux nombreuses questions que
peut soulever la fiscalité française. Il se présente de façon claire et
pratique, sous la forme d'une succession de questions-réponses, regroupées en
huit chapitres : présentation globale de la fiscalité française ; impôts sur
les personnes ; impôts sur les entreprises ; impôts indirects ; impôts
locaux, suivis d'une appréciation de la complexité du système fiscal
français, des pistes de réformes et enfin des implications de l'intégration
européenne et de la mondialisation en matière de concurrence fiscale.
J. Le
Cacheux, Les Français et l’impôt, Ed. Odile Jacob/La Documentation
française, coll. Débat Public, 2008, 11.90 €
|
|
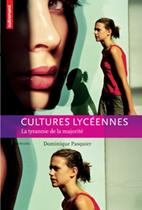
|
Comment être soi dans la vie
de groupe ? Est-il possible d’afficher ses goûts culturels ou ses choix
vestimentaires sans risquer le ridicule ? De se confier sans perdre la face ?
Pourquoi les relations entre les deux sexes sont-elles parfois si compliquées
à gérer ? Que faire de la culture des médias dans le cadre de l’école ?
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles répond ce livre.
Dominique Pasquier a mené
une enquête précise et minutieuse auprès de lycéens de la région parisienne.
Elle les a écoutés parler de leurs loisirs et de leurs passions : musiques,
jeux vidéo, sports, émissions de télévision… Elle a observé leurs échanges
quotidiens, sur leurs portables ou dans des chats sur Internet. Elle les a
questionnés sur leurs liens avec les autres, en voulant comprendre pourquoi
les communications à distance y tiennent désormais une place aussi
importante. Et au fil des témoignages qui émaillent ce livre, on découvre un
univers juvénile pétri de tensions. Tensions entre la plus grande autonomie
qu’accordent les parents et l’exacerbation des pressions au conformisme sur
le lieu scolaire. Tensions entre le désir de se livrer et les codes de
réserve qui prévalent dans les groupes masculins. Tensions entre la culture
qui est aimée en dehors de l’école et celle qu’il faudrait assimiler pour y
réussir. Les lycéens témoignent d’une grande lucidité sur tous ces problèmes
et cherchent à mettre en œuvre de multiples stratégies pour contourner les
obstacles à l’expression authentique de soi. Mais tous n’y parviennent pas
avec le même succès.
Cette enquête ne bouscule
pas seulement certains des stéréotypes sur la relation des jeunes aux
nouvelles pratiques de communication, elle montre aussi, et peut-être
surtout, combien il est difficile à l’adolescence de s’affirmer comme
individu.
D.Pasquier,
Cultures lycéennes, Ed. Autrement, coll. Mutations, 2005, 17 €
|
|

|
Que signifie être une petite fille au sein de nos sociétés
occidentales
contemporaines? Comment apprend-on
à devenir fille
et quelle fille doit-on
exactement
être à une époque et dans un type
de société où les rites de passage semblent avoir disparu ? Qu'est-ce qui fait grandir les filles, à l'heure de la culture, de la communication et de la consommation de masse ?
Réfutant souvent l'appellation de "petites filles", féminisées de plus en plus tôt, les filles dont il est question dans ce livre sont souvent désignées sous le terme de "préadolescentes". Elles ont entre 9 et 11 ans, et cet ouvrage les
saisit juste avant leur entrée au collège.
L'auteure explicite bien sûr le rôle joué par le monde des adultes (parents, enseignants, industries culturelles) comme prescripteurs. Cependant, l'ouvrage montre surtout comment se réalise l'appartenance de sexe dans les moments de loisirs où les petites filles se retrouvent entre elles, que ce soit dans la cour de récréation, chez elles ou lors des activités sportives. Il montre notamment comment la passion des petites filles pour l'univers de la musique, de l'image
et des stars tient une place
centrale dans leur
quotidien.
C.Monnot, Petites
filles d’aujourd’hui, Ed. Autrement, coll. Mutations, 2009, 19 €
|
|

|
Quelles sont les conséquences des mutations sociales
et politiques de la société sur le rapport actuel des jeunes à la
politique ? Partagent-ils encore avec leurs parents une même culture
politique, et a fortiori avec leurs grands-parents ? Comment les jeunes
se repèrent-ils entre la gauche, la droite, au sein de l'offre politique des
partis ? Quels sont leurs orientations idéologiques, leurs choix, leurs
votes ? Quelles sont les formes de leur implication, de leur
participation et de leur engagement ?
Ce livre rend compte de l'expérience politique dans
le temps de la jeunesse, entre 18 et 30 ans, conduisant chacun, selon son
itinéraire familial et socioprofessionnel, à la rencontre de son rôle de
citoyen dans la France d'aujourd'hui. Et il renverse nombre d'idées reçues.
Non, les jeunes ne sont pas dépolitisés. Plus
informés, ils sont aussi plus critiques et plus exigeants à l'égard de la
classe politique. Souvent pessimistes, ils expriment un désenchantement qui
reflète avant tout celui de leurs parents. Réalistes, ils n'ont pas rangé
leurs illusions et sont en demande de politique. Ils cherchent à restaurer
les valeurs d'engagement au travers d'actions concrètes, non différées et
donc efficaces. S'ils votent moins que leurs aînés, ils se mobilisent dans le
cadre d'actions collectives et interviennent souvent de façon spectaculaire
sur la scène publique. Enfin leur rapport à la politique, loin d'être
univoque, est socialement diversifié et révèle fractures et
dysfonctionnements dans la société.
Au début du XXIe siècle, leur expérience
politique s'avère donc plutôt dense, sans doute conflictuelle, mais aussi
riche de promesses. Le lien au politique des nouvelles générations se
recompose entre héritage et expérimentation, entre identification et
novation, et participe au renouvellement des valeurs et des pratiques des
futurs citoyens.
A.Muxel, L’expérience politique des jeunes, Presses
de Sciences Po, 2001, 18 €
|
|

|
Le capitalisme se transforme en profondeur depuis le
dernier quart du XXe siècle sous l’effet de la globalisation financière et
des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).
Émerge ainsi un nouveau capitalisme qui consacre le rôle dominant de la
logique boursière. En France, ce passage au « capitalisme actionnarial »
s’est effectué à un rythme accéléré à la suite de la privatisation du système
industriel et financier. L’emprise croissante de la finance internationale et
le développement des NTIC transforment le fonctionnement des entreprises,
fragilisent le salariat traditionnel et engendrent de nouvelles tensions,
dont les crises économiques et financières du début du XXIe siècle sont l’une
des manifestations.
Dans ce
livre, Dominique Plihon analyse les mutations économiques et sociales à
l’œuvre en montrant qu’elles sont de nature systémique. Il s’interroge
également sur les modes de régulation et les réformes radicales susceptibles
d’encadrer et de transformer le « nouveau capitalisme ». Le capitalisme
sortira-t-il transformé de la crise commencée en 2007-2008 ?
D.Plihon, Le
nouveau capitalisme, Ed. La Découverte, coll. Repères n°370, 2009, 9.50 €
|
|

|
La société industrielle liait un mode de production
et un mode de protection. Elle scellait ainsi l’unité de la question
économique et de la question sociale. La « société
post-industrielle », elle, consacre leur séparation et marque l’aube
d’une ère nouvelle.
Daniel Cohen analyse ici les ruptures qui ont
conduit le capitalisme du 21ème siècle à la destruction méthodique
de cet héritage : innovations technologiques, révolution financière,
transformations des modes d’organisation du travail, mondialisation des
échanges… En examinant les logiques à l’œuvre dans ces bouleversements, ces
« trois leçons » aident à comprendre les défis du monde à venir.
D.Cohen, Trois
leçons sur la société post-industrielle, Ed. Seuil/La République des
Idées, 2006, 10.50 €
|
|

|
L’association de l’État de
droit et de l’État social devait permettre de construire une « société
de semblables » où, à défaut d’une stricte égalité, chacun serait
reconnu comme personne indépendante et prémuni contre les aléas de
l’existence (chômage, vieillesse, maladie, accident du travail...) ;
« protégé », en somme. Ce double pacte - civil et social - est
aujourd’hui menacé. D’un côté, par une demande de protection sans limites, de
nature à générer sa propre frustration. De l’autre, par une série de
transformations qui érodent progressivement les digues dressées par l’État
social : individualisation, déclin des collectifs protecteurs, précarisation
des relations de travail, prolifération des « nouveaux risques »...
Comment combattre cette nouvelle insécurité sociale ? Que signifie être
protégé dans des « sociétés d’individus » ? C’est à ces
questions que tente de répondre Robert Castel.
R.Castel, L’insécurité
sociale, Ed. Seuil/La République des Idées, 2003, 10.50 €
|
|

|
Le libéralisme a échoué", "les inégalités
explosent "... affirmations péremptoires souvent reprises par les
médias. Mais qu'en est-il vraiment ? L'analyse des chiffres réserve souvent
des surprises. C'est le point de départ de ce livre. Bernard Salanié fait le
pari d'expliquer, de façon très claire, les mécanismes de l'économie de
marché (l'offre et la demande, le rôle des prix et du profit, les marchés
boursiers) en les illustrant par des exemples concrets. S'adressant à tout
lecteur, même s'il n'a aucune connaissance préalable, ce livre l'aidera à
former son propre jugement sur les principaux débats de politique économique,
un enjeu essentiel dans une société où ceux-ci constituent une part très
importante du débat démocratique. Sont ainsi abordés le libre-échange et la
mondialisation, la Politique Agricole Commune, le chômage, la redistribution
ou la lutte contre la pollution.
B.Salanié,
L’économie sans tabou, Ed. Le Pommier, 2004, 20 €
|
|

|
« Le travail est de retour,
mais quel travail ? Jusqu’à aujourd’hui nous avons travaillé pour vivre : il
nous faut désormais réconcilier la vie avec le travail. »
P.Boisard, Le nouvel âge du travail, Ed. Hachette littératures,
2009, 14.40 €
|
|
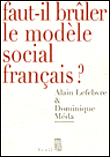
|
Chômage élevé, précarité,
intégration en panne, inégalités entre hommes et femmes, tout semble se
conjuguer pour entamer le moral des Français. Entraînés dans la
globalisation, ils doutent d'eux-mêmes, des politiques et de leur modèle
social, au moment où ils devraient construire avec vingt-quatre autres pays
le modèle social européen auquel ils aspirent. Leur faudra-t-il
progressivement se résigner au modèle libéral, dont on vante tant
l'efficacité ? Ce n'est pas une fatalité, car il existe en Europe un modèle à
la fois compétitif et solidaire, dont les performances impressionnent
d'autant plus qu'elles nourrissent une réelle cohésion sociale: celui des
pays nordiques. Il est grand temps de faire alliance avec ces Etats qui
partagent notre idéal et de développer ensemble une Europe économiquement
puissante et solidaire, autour de droits sociaux renforcés et d'un nouveau
type d'Etat providence pour le XXIe siècle.
A.Lefebvre et D.Méda, Faut-il brûler le modèle social français ?,
Ed. Seuil, coll. Essais, 2006, 9 €
|
|

|
Les cités de la banlieue ne se réduisent pas aux
problèmes qu'elles posent. Elles s'offrent aussi comme une richesse
potentielle pour la collectivité, comme une ressource.
Ressource d'initiatives économiques adaptées à des
niches inexploitées, ressource d'énergie entrepreunariale individuelle et
collective, ressource de transgression des idées reçues sur les valeurs en
cours, les bienséances, la norme bien-pensante, ressource de débrouillardise
et d'audace à tous niveaux, ressource d'inventivité finalement, d'une
inventivité à la mesure des difficultés ordinaires de sa population. La marge
sociale que représente la banlieue est d'une grande productivité sur un
spectre fort large. Il s'y produit le meilleur et le pire, selon le point de
vue ou la morale de chacun, mais il s'y produit des idées, des langages, des
musiques, des familles, des métissages, des ruptures, des valeurs, des mœurs
nouvelles.
M.
Hatzzfeld, La culture des cités, Ed. Autrement, coll. Frontières,
2006, 13 €
|
|
|
|

